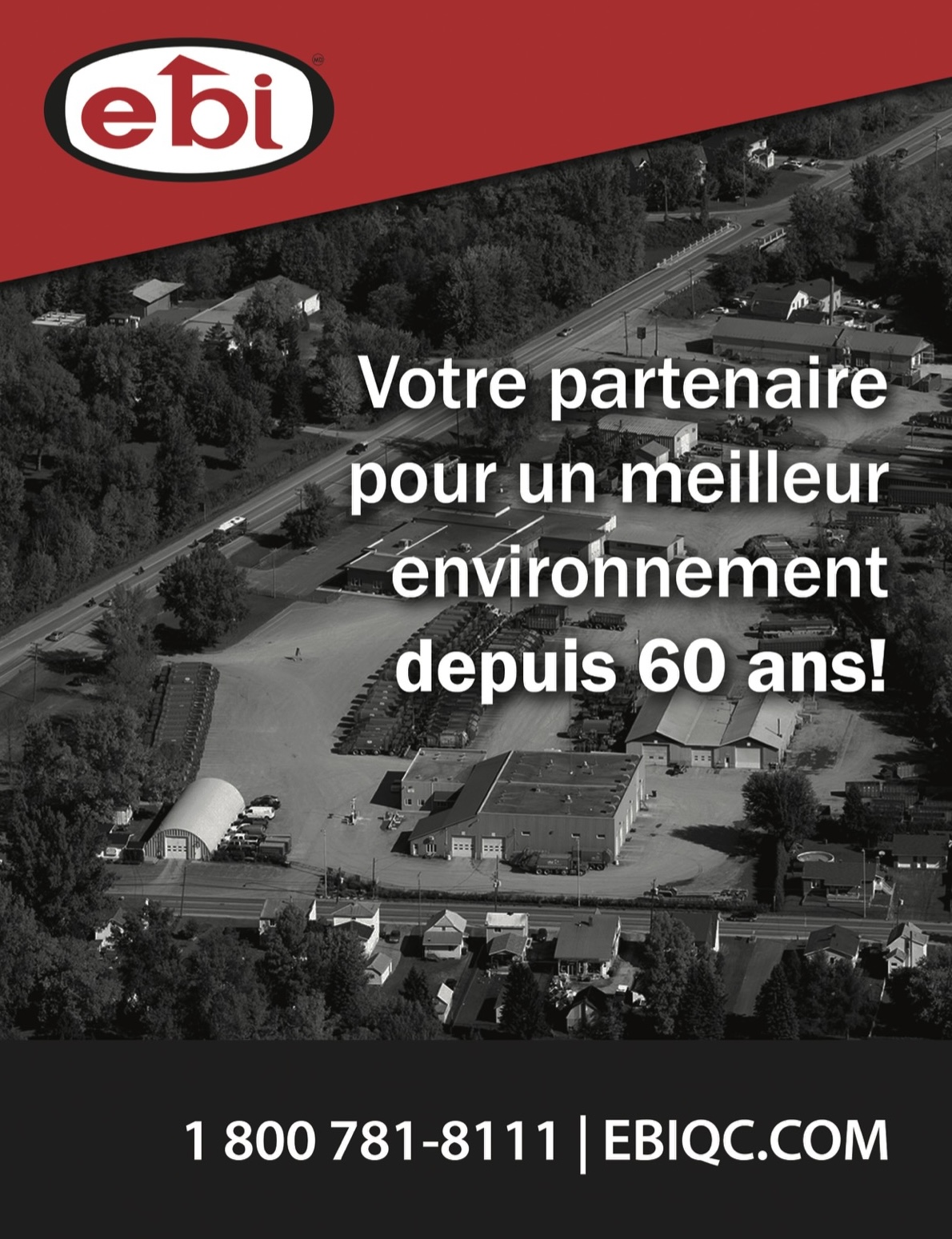Le système de gestion des matières résiduelles basé sur la responsabilité élargie des producteurs (REP) est en place depuis longtemps dans l’Union européenne. Il a même fait son apparition dans plusieurs États au sud de notre frontière. Est-ce la bonne avenue ? Devons-nous emboîter le pas ? La question ne se pose plus : le gouvernement du Québec a choisi cette voie il y a déjà bientôt 25 ans.
Aujourd’hui, la véritable question est de savoir pourquoi ce système n’a pas encore été étendu à l’ensemble des objets. Et, a posteriori, que faire pour que chaque système de REP mis en place soit un succès ?
À la lecture de notre reportage sur le sujet, vous noterez que, lorsqu’un système de REP s’étend à une nouvelle famille de produits, l’organisme qui le gère a besoin de plusieurs années pour s’organiser et développer ses infrastructures. Il faut parfois accepter que certaines solutions n’émergent qu’en cours de route, une fois le marché créé.
La Société de gestion des huiles usagées (SOGHU), créée en 2004 pour gérer le programme de REP des huiles, liquides de refroidissement, antigels, filtres et contenants, en est un bon exemple. Très efficace, cette dernière dépasse largement les seuils minimaux fixés par le gouvernement. Mais, ces résultats ne sont pas arrivés du jour au lendemain. De plus, la stabilité du programme, qui permet de récupérer une grande quantité d’huile, a convaincu la multinationale française Veolia de construire, en 2012, une usine de régénération des huiles usagées à Saint-Hyacinthe. Cette usine traite chaque année les 60 millions de litres récupérés par la SOGHU.
Même constat du côté d’AgriRÉCUP, qui atteint aussi les seuils fixés par le gouvernement pour les produits qu’elle a commencé à récupérer il y a plusieurs années, sur une base volontaire.
Surveillance et transparence
Cela dit, les responsabilités confiées aux organismes de gestion désignés (OGD) et reconnus (OGR) sont immenses. Responsables de collecter ses produits en fin de vie pour ensuite les envoyer chez un recycleur, ils doivent également s’assurer des débouchés afin de boucler la boucle vertueuse du Mobiüs. Et ils doivent faire tout ça de façon redoutablement efficace s’ils veulent atteindre les cibles gouvernementales, sans faire exploser les écofrais imposés à leurs membres, au risque de susciter de la grogne. Éco Entreprises Québec a fait face à cette dure réalité en début d’année.
Le gouvernement doit s’assurer que les OGD et les OGR font bien leur travail. Bien sûr, il faut tolérer que tout ne roule pas parfaitement dès le départ et que des angles morts soient découverts en cours de route. Mais la vigilance demeure essentielle.
Il a d’ailleurs dû d’intervenir récemment dans le dossier de la consigne. S’il a accepté de retarder la troisième phase d’implantation, il a aussi ordonné la tenue d’une enquête afin de comprendre pourquoi l’Association québécoise de récupération des contenants de boissons n’arrive pas à remplir ses engagements. Dans ce dossier de REP, on assiste, ni plus ni moins, à un mauvais vaudeville.
Cet exemple est probant. Si le gouvernement souhaite maintenir l’adhésion du public et des producteurs, il doit jouer adéquatement son rôle de surveillance. Il doit aussi s’assurer que les OGR et les OGD font preuve de transparence concernant leurs opérations et leurs résultats.
Le gouvernement doit présenter une vision claire du système de REP. Il doit aussi en accélérer le déploiement aux autres produits de consommation, notamment les résidus provenant de l’industrie de la construction, rénovation et démolition, même si le défi est important. Et surtout, il doit veiller à ce que tous les acteurs travaillent dans le même sens, avec transparence et imputabilité. Ainsi, dans 25 ans, on pourra peut-être dire que la révolution de la REP a été un succès.
Dans le calepin
On parle souvent de la chaine de valeur et de l’importance que chaque maillon joue dans l’atteinte des objectifs de l’industrie. Or, une nouvelle récente m’a laissé perplexe; le ministère de l’Économie, de l’Innovation et de l’Énergie vient de retirer son soutien aux centres collégiaux de transfert technologique, ce qui représente 20 % de leur financement public.
Ces organismes, déjà sous-financés, faisaient de petits miracles. Je pense particulièrement à notre chroniqueuse et amie Claude Maheu-Picard, du Centre de transfert technologique en écologie industrielle (CTTÉI). Spécialisé en économie circulaire, ce centre recherche des débouchés rentables et favorise les symbioses industrielles. Un manque de cohérence et une économie de bout de chandelle.