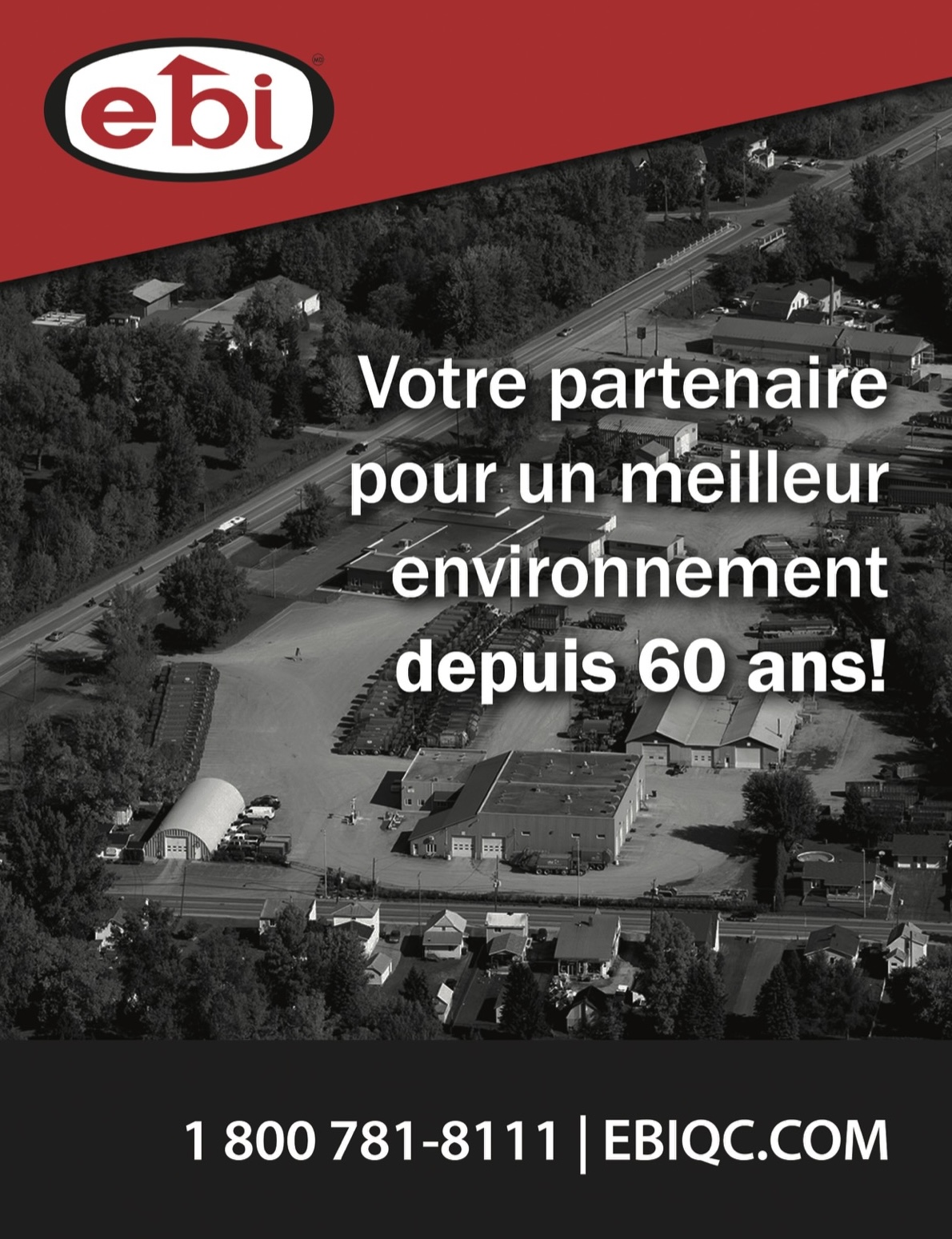Le recyclage des matières résiduelles fertilisantes (MRF) est une pratique écoresponsable qui offre une foule d’avantages environnementaux. La valorisation par retour au sol en est la pierre angulaire, puisqu’elle permet de détourner chaque année des milliers de tonnes de résidus verts et alimentaires et de boues d’épuration, composts, digestats, cendres de bois et poussières de fours des sites d’élimination.
Au-delà de ses bénéfices écologiques, cette pratique suscite des retombées agronomiques majeures. L’utilisation de MRF améliore la structure, la fertilité et la conservation des sols. Concrètement, recycler les matières organiques ne fait pas que réduire notre empreinte environnementale : c’est un levier puissant pour une agriculture plus durable.
Il est donc difficile de comprendre pourquoi, malgré une longue liste d’avantages, le recyclage des MRF stagne depuis plusieurs années.
Une stagnation causée par un encadrement défaillant
Avec des bénéfices qui surpassent largement les craintes, on pourrait s’attendre à ce que la filière ait le vent dans les voiles. Pourtant, après une croissance soutenue depuis les années 2000, le taux de recyclage des MRF a chuté entre 2015 et 2018. Une remontée a bien eu lieu en 2021, mais elle reste en deçà des objectifs fixés par le gouvernement du Québec.
Le principal coupable ? L’absence d’un cadre réglementaire clair et contraignant. Jusqu’ici, l’encadrement des MRF reposait essentiellement sur le Guide sur le recyclage des matières résiduelles fertilisantes, édition 2015, un document sans force légale. Ce flou juridique a laissé le champ libre à des interprétations variables, souvent contradictoires, d’un territoire à l’autre.
Des municipalités qui freinent le progrès
Ce vide réglementaire, loin de favoriser la souplesse, a permis à certaines municipalités d’imposer leurs propres règles, souvent plus restrictives que celles du gouvernement. Plutôt que de soutenir une filière porteuse, plusieurs administrations locales ont érigé des obstacles bureaucratiques ou adopté des règlements trop sévères sans fondement scientifique solide.
Le compost, ça sent, mais pas plus que le « pas dans ma cour » de certaines municipalités
Dans certains cas, des MRF conformes aux exigences environ-nementales ont été interdites d’utilisation sur un territoire, simplement en vertu d’un règlement municipal imposant des distances d’épandage irréalistes. Ailleurs, des moratoires prolongés indéfiniment ont gelé des projets viables. Le tout, souvent sous la pression de groupes citoyens mal informés ou par crainte d’un risque environnemental pourtant maîtrisé.
Cette situation crée une inégalité d’accès aux MRF selon les régions, complique le travail des entreprises spécialisées et ralentit considérablement l’innovation dans le domaine. Un projet accepté dans une MRC peut être bloqué dans une autre pour des motifs purement politiques ou administratifs.
Ce paradoxe est d’autant plus frappant que plusieurs de ces municipalités se revendiquent comme des leaders en environnement. À longueur de discours, des mairesses et maires s’affichent comme des défenseurs du climat, engagés pour la transition écologique. Pourtant, en créant un milieu d’affaires défavorable à la croissance de la filière, ils compromettent une solution concrète et éprouvée pour améliorer la santé des sols, réduire les émissions de gaz à effet de serre (GES) et boucler la boucle en ce qui concerne le processus du traitement des matières organiques. Cette incohérence affaiblit la crédibilité des engagements municipaux et retarde des avancées pourtant à leur portée.
Respecter ses champs de compétences
L’environnement demeure avant tout une responsabilité du gouvernement du Québec. C’est à lui qu’il revient d’établir les règles du jeu, car il détient l’expertise scientifique, technique et réglementaire nécessaire pour encadrer l’utilisation sécuritaire et efficace des MRF. Laisser chaque municipalité définir ses propres standards crée de la confusion et de l’incohérence, et mine l’intérêt collectif. Seul un encadrement provincial solide peut garantir des pratiques uniformes, fondées sur la science et bénéfiques pour l’ensemble de la société.
Une réglementation forte à l’horizon
L’automne 2025 pourrait néanmoins marquer un tournant. Après des années d’attente, le ministère de l’Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs a publié, en mars dernier, le Code de gestion des matières résiduelles fertilisantes, dont les exigences entreront en vigueur le 1er novembre prochain.
Ce code définira notamment :
- des critères de qualité des matières, basés sur leur provenance et leur usage ;
- es normes claires concernant la distance d’épandage et la protection des milieux sensibles ;
- un processus d’autorisation encadré, transparent et uniforme ;
- des obligations de suivi et de reddition de comptes adaptées au terrain.
Le Code intégrera également les plus récentes avancées scientifiques, notamment en ce qui concerne la détection et le contrôle de contaminants, comme les substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées (SPFA). Ce nouveau cadre a le potentiel de rétablir la confiance entre les acteurs du milieu, d’uniformiser les pratiques et, surtout, de recentrer les décisions sur des bases scientifiques plutôt que politiques.
Ce ne sera pas une solution miracle. Mais c’est un pas significatif vers une économie circulaire cohérente, efficace et équitable. Un signal fort envoyé aux agriculteurs, transformateurs et citoyens qui croient qu’une meilleure gestion de nos matières organiques est possible.